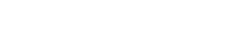S’évader de son histoire
On ne peut pas vivre si on ne se raconte pas une histoire. Depuis son apparition dans la vallée de l’Omo, il y a trois cent mille ans, l’homo sapiens ne cesse de se faire du cinéma. Certains « sapiens » semblent abonnés aux problèmes de cœur, d’autres aux problèmes de fric, de santé, de (beaux) parents ou d’enfants (atypiques). Cette histoire les soulève, les enivre, égare, les emprisonne, les étouffe, les empoisonne ou empoisonne les collatéraux. Elle offre cependant une carte routière. Elle fixe une direction à suivre, et quelquefois une feuille de route. Elle colore de signification les événements qui pleuvent. Elle organise la pensée comme la tente d’un cirque autour d’un pilier central. Elle modélise le personnage à la manière d’un squelette. Elle apporte à l’action sa cohérence et sa continuité. Pris en sandwich entre des prédispositions originelles têtues et une situation mouvante mais objective, avec laquelle il faut bien composer, le narratif s’impose comme un schéma central, l’ogive de la cathédrale intérieure. Pris en étau, sur les côtés, entre des normes culturelles sans concession et les leçons désabusées d’un parcours personnel erratique, il fonctionne comme l’essieu d’une roue motrice.
Le niveau de conscience du narratif est ambigu. La conscience s’épanouit au niveau supérieur de la personnalité, en se confrontant à une situation. Les hommes sont d’abord ce que leur situation veut qu’ils soient. Le caractère, issu des profondeurs héréditaires, reste longtemps inconscient. Ce sont les autres qui perçoivent la marionnette, la logique insidieuse du destin, qui se dévoile trop tard, comme dans un polar, où on ne découvre le vrai coupable qu’à la dernière page. Le caractère d’une personne ne se dévoile que dans la durée. Et c’est pourquoi on ne peut le comprendre que rétrospectivement. Le narratif n’est ni vraiment conscient, ni vraiment inconscient. Il trempe dans le clair-obscur du subconscient. Coincé par le caractère, mais bousculé par la situation, l’écosystème, l’inattendu, il peut remuer lentement comme le magma de lave, piégé entre l’écorce terrestre et le noyau de fer ou de nickel. A la différence des caprices olé-olé de la situation ou des invariants butés du caractère, le narratif évolue lentement, et même de plus en plus lentement. Il mûrit au pas des problématiques de l’âge ou au hasard des circonstances. Il n’est pas rare qu’à vingt ans l’amour l’affole ; à quarante, c’est l’argent ; à soixante, la supposée vérité ; à quatre-vingt, les examens de santé. Le narratif est un fantôme familier, comme ces visiteurs du soir qui viennent nous visiter dans les quelques minutes qui précèdent l’évaporation dans le sommeil, et qui parfois reviennent au petit-matin, à l’heure de la rosée et de la condensation.
Cela ne signifie pas que le narratif soit digne de confiance. L’une des meilleures définitions possible de l’intelligence est la capacité à sortir de soi, à s’évader hors de son histoire, à se délester de ses a priori, afin de pouvoir enfin épouser les contours du réel avec agilité. Cette aptitude au décentrage constitue également une condition essentielle du bien-être, celui qu’on s’octroie ou celui qu’on répand. Elle fournit un antidote à la peur de vieillir, au désespoir de décliner. Il est aussi dangereux que tentant de s’abandonner à son histoire favorite. Ses implicites, ses postulats, ses préjugés peuvent compromettre le moulage de la conduite autour de la réalité. Ses influences culturelles risquent de le faire dériver hors de ses eaux territoriales et l’amener à trahir un tempérament qui ne le lui pardonnera pas. A vouloir ménager la chèvre et le choux, le caractère et la situation, il risque de trahir le choux et la chèvre. La situation est exigeante, mais dans le court-terme uniquement. La cohérence du caractère s’inscrit au contraire dans le long terme. Elle s’accommode des erreurs de parcours et se contente de donner quand il faut les coups de pouce nécessaires à la correction du tir. Mais dans le long terme elle est redoutable. Quand on la trahit, elle ne vous laisse le choix qu’entre mettre les voiles ou mourir intérieurement.
Sur cet océan à la merci des vents contradictoires, le narratif pilote le navire au présent de l’indicatif. Il organise autour de lui la réflexion et l’action immédiate. Il fait de son mieux pour négocier des compromis au fil de l’eau. Vis-à-vis de la couche supérieure de la situation, instable et capricieuse, il garantit la cohérence et la prédictibilité. Mais vis-à-vis des couches inférieures, des intangibles du tempérament, il exerce au contraire une fonction d’assouplissement, qui peut aller jusqu’à la surcompensation. Il n’est pas rare que l’empathie naturelle et la générosité démontrée s’excluent mutuellement. Il n’est pas rare que l’obsession dominatrice prenne ses racines en un terrain fragilisé ; la colère dénonciatrice, dans des peurs inavouables. Pour comprendre qui est l’homme, il suffit d’observer ce qu’il veut paraître ou d’écouter ce qu’il raconte. Souvent il est à l’opposé. A la différence du caractère, qui suit tranquillement son chemin, le narratif vit dans la crainte d’être démasqué. Sa construction artificielle joue dans la surenchère. Elle se débrouille pour se trouver des alliés, des témoins, des comparses. Le terrain est argileux.
L’affinité se tisse avec des similaires : même tranche d’âge, même souche socio-culturelle, même bord politique. La sociologie des quartiers, les lieux de loisirs ou de villégiature, le choix du siège, du spectacle ou de l’école installent le semblable à côté du semblable. Les cercles, les associations, les formations, les soirées entre amis ou les anniversaires sont là pour prolonger la danse avec des partenaires, qui partagent nos croyances, nos préjugés, nos archétypes. Le métier qu’on choisit, le milieu professionnel, la situation familiale ou sociale jouent une fonction de renforcement. Les Dominateurs se débrouillent pour dominer en toute légitimité ; les Protecteurs, pour protéger ; les Obéissants, pour obéir ; les Théâtraux, pour faire leur numéro. Le manège tourne. Il tourne même de plus en plus vite, en système isolé, quand les contrariétés fâcheuses de la vie réelle ne viennent pas enrayer la mécanique. Le départ en retraite, dans une résidence secondaire isolée, en face-à-face avec son complice historique (qui s’avise souvent d’être aussi le conjoint) est une garantie d’ankylose. Privée des contradictions et des contradicteurs qu’apporte la vie active, la personne n’a plus alors qu’à fredonner son refrain de plus en plus fort, tout en le simplifiant jusqu’à la caricature. En fin de vie, on n’émet plus parfois qu’une seule idée fort simple, du genre : je suis fort, je dois me faire plaisir, je suis un grand malade fragile, je ne dois dépendre de personnes, j’ai toujours été seul et je le serai toujours, je dis Non ou Zut à tout. C’est alors que les amis, les enfants, les petits enfants commencent à se faire rare, à s’éloigner à pas de loup. La personne isolée n’attire plus personne car elle ne peut plus comprendre personne, murée dans sa vieille rengaine, ses certitudes, sa vérité singulière. Elle meurt en quelque sorte de son vivant.
Avec le temps, l’action suit le mouvement d’auto-amplification du discours. Elle se laisse aspirer dans une spirale d’auto-renforcement. Dans la seconde moitié de la vie, la remyélinisation renforce la gaine de protection des neurones. Elle accélère le traitement d’information dans les circuits déjà en place. Elle conduit à la virtuosité les schémas cognitifs qui fonctionnent déjà bien. Elle peut en revanche compliquer la mise en place de fonctionnements nouveaux. Avec le temps, on devient encore meilleur dans les tâches où on était déjà bon, tandis qu’il devient de plus en plus difficile d’acquérir de nouveaux algorithmes. Les langues qu’on apprend jeune ne cessent de se perfectionner, pourvu qu’on les mette en pratique. Il est en revanche difficile, au-delà de quarante ans, d’assimiler, et plus encore de prononcer avec la bonne intonation, une langue nouvelle à partir de zéro. Au cœur d’une spécialité on ne vieillit pas. On continue à progresser. C’est pourquoi il est bon de ne pas trop se spécialiser au commencement de l’âge adulte, de laisser au contraire grand ouvert l’angle de son esprit. L’idéal à vingt ans est de collectionner les expériences insolites, de s’initier au maximum de disciplines, de cultures, de musiques, de cuisines. On plante ainsi des fondations élargies, qui plus tard permettront l’adaptabilité et la polyvalence, a fortiori dans un monde en accélération. Le rétrécissement de conscience propre à la fin de vie peut être prévenu au commencement de la vie par la culture de la curiosité, de l’incertitude et de la relativité. Sinon le toboggan en entonnoir ne fera pas de cadeau. La personne se robotise et se caricature. Les habitudes l’enveloppent d’un exosquelette, qui bientôt l’emprisonne et l’étouffe comme un lierre. La boîte à musique se double alors d’un automate.
Je propose d’appeler ce dérapage Radicalisation. Chaque narratif peut se dégrader en une version radicalisée : le Consciencieux se fait Perfectionniste ; le Dominateur, Tyrannique ; le Narcissique, Méprisant ; le Pionnier, Transgressif ; le Théâtral, Dramatique ; le Vigilant, Accusateur. Les distorsions cognitives deviennent alors inconditionnelles. Des personnalités communes on glisse vers le pathologique. Le narratif, débridé, s’emballe et devient fou. L’isolement détruit les capacités de socialisation. Le pouvoir absolu rend absolument fou. La personne se laisse aspirer dans le vortex de l’évier qui se vide. En se retranchant de la vie réelle, en s’isolant, en vieillissant, en s’immobilisant, le narratif provoque une inadaptation et une incompréhension qui se renforcent mutuellement. C’est parfois ce qui arrive aux dictateurs en fin de règne. Le narratif s’est développé comme un cancer ou comme un nénuphar. Il occupe la totalité de l’espace disponible sur le disque dur.
Ça ne lui suffit pourtant pas. Le narratif, qui se propage à l’intérieur comme un cancer, se projette à l’extérieur comme un virus contagieux. La vie est une histoire de structures qui cherchent à se perpétuer. Afin de persévérer dans leur être, et de résister à la disparition qui les menace, les schémas cognitifs vont tenter de s’exporter, de convertir les systèmes extérieurs à leur logique interne. Comme les idéologies, les religions, les courants politiques ou les épidémies, les algorithmes singuliers, conçus initialement pour répondre aux besoins d’une situation particulière, déposée sur un caractère particulier, vont chercher des disciples, des adhérents, des bénéficiaires ou des victimes, afin de les coloniser. Elles vont aussi désigner comme hérétiques tout ce qui pourrait les contredire. Elles vont œuvrer pour mettre en place des mécanismes de filtrage des informations entrantes, ostraciser les fréquentations étrangères, ne laissant pénétrer dans la danse ou dans le pré carré, que les sympathisants authentifiés, habilités ou agréés. On ne supporte plus que les complices. Les couples et les partenariats professionnels s’échafaudent sur l’enchevêtrement de narratifs imbriqués, le jumelage de folies qui s’emboîtent et se promettent mutuellement la réalisation : un Dominateur avec un Obéissant, un Sauveur avec un Hypersensible, un Accusateur et un Perfectionniste. Les rencontres perpendiculaires ne s’attardent guère. Les narratifs identiques font rarement bon ménage. Deux Narcissiques, deux Théâtraux ou deux Accusateurs qui se croisent s’écharpent ou passent leur chemin.
Cependant, on ne peut toujours pas vivre si on ne se raconte pas une histoire. Le vrai problème se pose avec l’apparition de la souffrance, celle qu’on inflige ou celle qu’on s’inflige. Si la personne, plus névrosée que psychotique, conserve suffisamment de lucidité pour accepter son aveuglement relatif, elle peut explorer plusieurs pistes d’émancipation.
La première consiste à s’extraire hors de la systémique en place. Elle procède par un mouvement de soustraction. Quand une personne est prise au piège d’un écosystème hyper-cohérent, où tout se tient, tout est logique : les occupations, les responsabilités, les fréquentations, les croyances, les discours et les codes, la meilleure façon de s’affranchir, est de partir, seul, en voyage, dans un endroit qu’on ne connaît pas, déménager dans un autre pays, pour un autre métier, avec de nouveaux amis, une nouvelle culture, des nourritures inconnues. Cette immersion exigera l’incorporation d’un autre narratif, qui relativise l’ancien.
L’immersion dans plusieurs narratifs différents, comme en plusieurs vies parallèles, induit parfois le goût amer de la dissonance cognitive. Mais c’est précisément sa vertu salutaire. Les narratifs de naguère doivent parlementer, rivaliser, se bagarrer ou se compromettre avec les narratifs de l’ici-maintenant. La personne est contrainte de s’évader hors de son personnage historique. Alors, elle gagne en souplesse, en écoute attentive, en besoin de partage, ce qu’elle perd en cohérence, en unité, en perfection formelle. On lui souhaite de continuer à entretenir sa neuro-biodiversité par d’autres voyages à l’aventure, sans bagage et sans copilote. Elle se donne ainsi une chance d’entretenir sa neuro-biodiversité, de résister à l’entropie, de combattre plus efficacement le temps qui passe et qui ne rêve que de tout aplatir par l’automatisation. Pour s’évader de son histoire, on peut collectionner toute une garde-robe de narratifs, pourvu qu’ils soient bien assortis. La déclinaison de la personne en plusieurs personnages facilite la médiation entre les impératifs de la situation et les préférences de la nature.
La neurostimulation peut également être favorisée par une exposition massive à la rencontre inattendue. Les nœuds décisifs d’une vie se font souvent autour d’une rencontre improbable, qui fortuitement dévie la trajectoire prévue, par mimétisme, par induction ou en contradiction. Tout se passe comme si les points d’inflexion d’un destin prenaient appui sur les rencontres qu’on n’aurait pas dû faire. Ces rencontres ne peuvent pas, par définition, être planifiées. Mais il reste possible de s’exposer aux rencontres improbables et ne pas laisser filer les occasions qui se présentent. L’exposition à l’imprévu, à l’inconnu, à l’inconfort peut retarder la pétrification du narratif, qui sinon se renforce tout seul et part en vrille comme une toupie. Tant qu’il est challengé par les responsabilités professionnelles ou familiales, il est obligé au contraire de composer, de nuancer, de s’adoucir, de se relativiser. C’est pourquoi 60 ans est un âge dangereux. La fin de la vie professionnelle, c’est quelquefois la mort sociale ou l’enlisement dans la folie de l’intériorité pure. Quand on cesse d’être utile objectivement, les fantômes sortent de leur cage et prennent leur revanche.
Au narratif individuel se superposent enfin les narratifs communs, comme celui de la profession, du milieu, du pays, de la civilisation ou de l’époque, qui évoluent de la même façon que les narratifs individuels, avec les mêmes risques de radicalisation quand ils sont isolés, suite à la fermeture de leurs frontières. Avec la différenciation des individus, le narratif culturel est l’un des rares mécanismes qui puisse apporter un peu de cohésion à la famille, l’équipe, l’entreprise ou le corps de métier.
La vérité universelle toute crue est au fond assez simple. Tout change, tout le temps, partout. Et à la fin, c’est le plus fort gagne. Cette vérité est bien-sûr insoutenable, et donc intolérable, pour les organisations sociales particulières, qui aspirent à perpétuer leurs structures particulières, leurs sinécures et leurs organisations hiérarchisées. Afin de justifier leurs privilèges, les élites entretiennent une mythologie locale, un appareillage de symboles et de rituels, un corpus de légendes aussi convaincant que possible par le canal de la religion, de l’école, de la presse, des médias ou des réseaux sociaux. Ce narratif commun peut tenir la route un certain temps, aussi longtemps que les privilèges de son élite sont justifiés par l’efficacité de son leadership, ou que la pression aux frontières reste contenue par le prestige ou les exportations nationales. Au fil du temps, le prestige extérieur s’érode. La balance des échanges perd parfois l’équilibre. Le maintien des acquis ne peut plus se conserver que par l’exercice d’un pouvoir de nuisance : grèves- surprises dans les transports, instauration de réglementations labyrinthiques, que seuls les diplômés de Science Po Paris peuvent dénouer. Le roman national ne parvient plus à jouer son rôle de ciment à l’intérieur et de rempart vis-à-vis de l’extérieur. La légende collective est devenue inappropriée. Elle n’inspire plus personne. Le systémique s’effondre, jusqu’à ce qu’une autre histoire, plus inspirante, soit introduite, de l’extérieur ou de l’intérieur, par de jeunes barbares, qui décrètent, au lendemain de leur coup d’état, une cure d’austérité salutaire, un choc de simplification, une mise à plat des subtilités byzantines qui protégeaient l’élite déchue. Le cycle peut alors recommencer, avec un narratif qui redistribue les cartes, oriente différemment le paradigme et réenclenche une dynamique par effet domino. La France de 2024 n’est peut-être plus très loin de cette situation. Le roman national de l’État Providence, introduit au lendemain de la Seconde Guerre Mondiale par les héros de la Résistance, s’est aujourd’hui radicalisé et dilué dans une culture de l’assistanat et de la victimisation, avec ses principes conservateurs, ses rentes injustifiées, ses procédures alambiquées que seuls les effendis peuvent déchiffrer. Il est temps de se raconter une nouvelle histoire. Ou au moins de s’évader du roman actuel par les deux même pistes d’émancipation dont l’individu dispose : la soustraction globale aux prêt-à-porter comportemental et l’exploration de l’inconfortable au-delà de ses frontières.